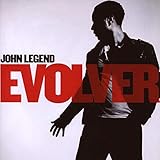Julie Pagis
| Naissance |
Reilhanette |
|---|---|
| Nationalité |
|
| Formation |
ENS EHESS |
|---|---|
| Travaux | Sociologie politique |
Julie Pagis, née en 1980[1] au lieu-dit Le Chavoul à Reilhanette[2], est une sociologue française, elle est spécialisée en sociologie politique. En octobre 2014, elle est l'une des 280 signataires de l'appel à des états généraux des sciences sociales critiques[3].
Origines
Julie Pagis est issue d'une famille de soixante-huitards : ainsi ses parents ingénieurs agronomes, ont quitté leurs situations respectives à Marseille pour s'installer en Drôme provençale où ils exploitent une ferme depuis 1974[4]. Elle a été élève de l'École normale supérieure d'Ulm[5] en biologie avant de bifurquer vers les sciences humaines et sociales[4].
Recherches
L'un des sujets d'études de Julie Pagis est celui de la structuration des relations de sociabilité entre enfants (notamment avec Wilfried Lignier)[6]. En effet, elle cherche à mettre en exergue le lien entre propriétés sociales des enfants (genre, origine sociale et origine migratoire) avec cette structuration. En analysant les expressions d'inimitié des enfants envers leurs pairs, elle a relevé l'importance des critères issus des registres domestiques et scolaires (par exemple la saleté ou les mauvaises notes)[7],[8].
Préalablement, Julie Pagis a consacré sa thèse à l'école des hautes études en sciences sociales et ses recherches aux incidences biographiques du militantisme en mai 68. Elle y déconstruit la supposée existence d'une catégorie homogène de soixante-huitards en analysant les diverses matrices conduisant au militantisme et s'intéresse à l'héritage de mai 68 chez les enfants des acteurs militants de cette période[1],[9],[10].
Chroniques
Depuis la rentrée 2014, Julie Pagis est chroniqueuse chaque mois — en alternance avec Cyril Lemieux, Frédérique Aït-Touati et Nathalie Heinich — dans le journal Libération[11] : ainsi ses trois premières chroniques s'intitulaient « Moi, des fois, je dis Sarkozizi » (septembre 2014), « Non, le patriotisme n'a rien d'universel ! » (octobre 2014) et « Saint-Denis, cas d'école » (novembre 2014).
En septembre 2014, elle a également publié la chronique « Contre la gauche de renoncement, revenons aux slogans de mai 68 » dans le journal Le Monde[12].
Œuvres
Ouvrages
- Mai 68, un pavé dans leur histoire : événements et socialisation politique, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Sociétés en mouvement », , 339 p. (ISBN 978-2724615906)
- Entraide familiale et solidarités entre les générations, Paris, La Documentation française, coll. « Problèmes politiques et sociaux », , 200 p. (ASIN B002L4LP1Q)
- Les incidences biographiques du militantisme en mai 68, École des hautes études en sciences sociales, , pdf [lire en ligne] (thèse)
Articles
(liste non exhaustive)
- Wilfried Lignier et Julie Pagis, « Inimitiés enfantines », Genèses, no 96, (lire en ligne)
- Julie Pagis, « Contre la gauche de renoncement, revenons aux slogans de mai 68 », Le Monde, (lire en ligne)
Références
- ↑ Revenir plus haut en : 1,0 et 1,1 Diane Galbaud, « Mai 68 en héritage », Sciences humaines, (lire en ligne) :
.« Julie Pagis, une « fille de hippie » née en 1980 »
- ↑ Les incidences biographiques du militantisme en mai 68, École des hautes études en sciences sociales, , pdf [lire en ligne], p. 10.
- ↑ Appel à des états généraux des sciences sociales critiques, L'Humanité, 17 octobre 2014.
- ↑ Revenir plus haut en : 4,0 et 4,1 Sébastien Banse, Julie Pagis / Sur la trace des soixante-huitards, novembre 2014.
- ↑ Les incidences biographiques du militantisme en mai 68, École des hautes études en sciences sociales, , pdf [lire en ligne], p. 13.
- ↑ Wilfried Lignier et Julie Pagis, « Inimitiés enfantines », Genèses, no 96, (lire en ligne).
- ↑ Baptiste Coulmont, « L'école de la détestation », Le Monde, (lire en ligne) :
.« L'enquête pendant plus de deux ans dans deux écoles primaires parisiennes porte sur la manière dont les enfants voient le monde, c'est-à-dire sur leur manière de classer, leur « sens social ». »
- ↑ Marie Quenet, « L'école de la méchanceté », Le Journal du dimanche, (lire en ligne) :
.« Pendant deux ans, ils ont interrogé Marielle, Louison et d'autres enfants de 6 à 11 ans fréquentant deux établissements de l'Est parisien. Résultat : l'école semble parfois bien éloignée de L'Île aux enfants. »
- ↑ Éric Aeschimann, « Ces soixante-huitards qui ne sont pas devenus des stars », Le Nouvel Observateur, (lire en ligne)
- ↑ Vincent Porhel, « Histoire, femmes et sociétés : 68', révolutions dans le genre », Clio, no 29, (ISSN 1252-7017, lire en ligne, consulté le ) également publié aux Presses Universitaires du Mirail (ISBN 9782810700431), 288 p.
- ↑ Tous les articles de Julie Pagis publiés dans Libération, Libération.
- ↑ Julie Pagis, Contre la gauche de renoncement, revenons aux slogans de mai 68, Le Monde, 11 septembre 2014.
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la sociologie